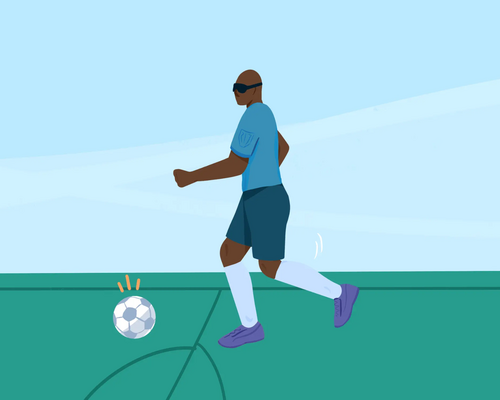Personne sourde ou public malentendant : définition de la surdité
Quelle est la différence entre une personne sourde et malentendante ?
L’Institut de Recherche du Bien-être, de la Médecine et du Sport santé (plus connu sous l'acronyme IRBMS) définit la surdité comme une déficience sensorielle de communication et d’acceptation sociale. 360 millions de personnes dans le monde sont touchées par une diminution des champs auditifs et de la parole, soit en intensité (perte de qualité), soit en fréquence (perte de quantité). Conséquence : le message est perçu plus faiblement ou de manière déformée.
Plus simplement, Arnaud Cuvellier - notre expert en activité physique adaptée - nous explique : « On parle de personnes sourdes pour décrire celles et ceux qui n’ont plus de fonction auditive. On les distingue des personnes malentendantes qui, elles, ont un reste auditif plus ou moins important, pouvant être amélioré partiellement avec un appareillage. »
On parle alors de niveau de décibels, qui se quantifie par des tests audiométriques (appelés audiogrammes) selon des fréquences conversationnelles de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Cela ne signifie pas que toutes les personnes malentendantes ont des appareils auditifs. « Pour certains, l’appareillage est difficile, car cela entraîne des maux de tête ou des problèmes d’adaptation. Il existe aussi un frein financier, puisque les dispositifs restent encore très coûteux. »