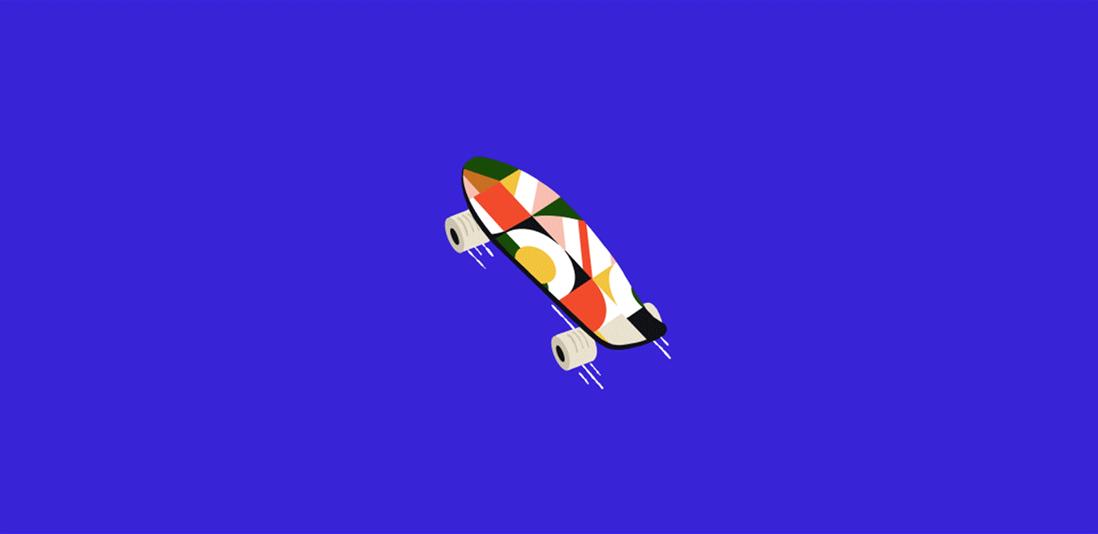Le skateboard comme moyen d'expression
C’est comme ça, dès que l’on monte sur une planche de skate pour rider, on affiche une allure, un style. Shogo Kubo, l’un des pionniers du skateboard dans les années 1960 l’affirmait sans détour : « le style, c’est tout ». Sur la planche, développer son style constitue l’un des enjeux majeurs. La créativité associée à l’entraînement et la persévérance y sont exigés pour maîtriser les techniques et « rentrer » des figures. Une dynamique qui n’est pas directement branchée à la performance sportive où des règles précises encadrent la pratique et la qualifient en termes de résultats chiffrés. Dans son essence, le skateboard se rapproche bien plus d’un moyen d’expression.
On crée des mouvements non codés, non encadrés, qui ne se laissent pas consigner dans un tableau de valeurs.
La performance, s’il faut en avancer une, est tout artistique, l’œuvre se fait au gré de la progression de la planche et de son·a protagoniste. Un kick flip visionné
en slow motion est une merveille de grâce et de précision. Pour parvenir à cela, il faut suer, tomber, se relever, recommencer, s’accrocher encore et encore jusqu’à ce que le trick rentre. Ce qui est visé ? Un idéal esthétique qui demande engagement physique et adhésion spirituelle. Un sport fun, en bref, mais dont la culture est si riche et protéiforme qu’elle marque profondément le mode de vie de ses pratiquant·e·s. L’art du mouvement qu’entraîne le skateboard est une manière d’être créatif et de cultiver sa propre identité,