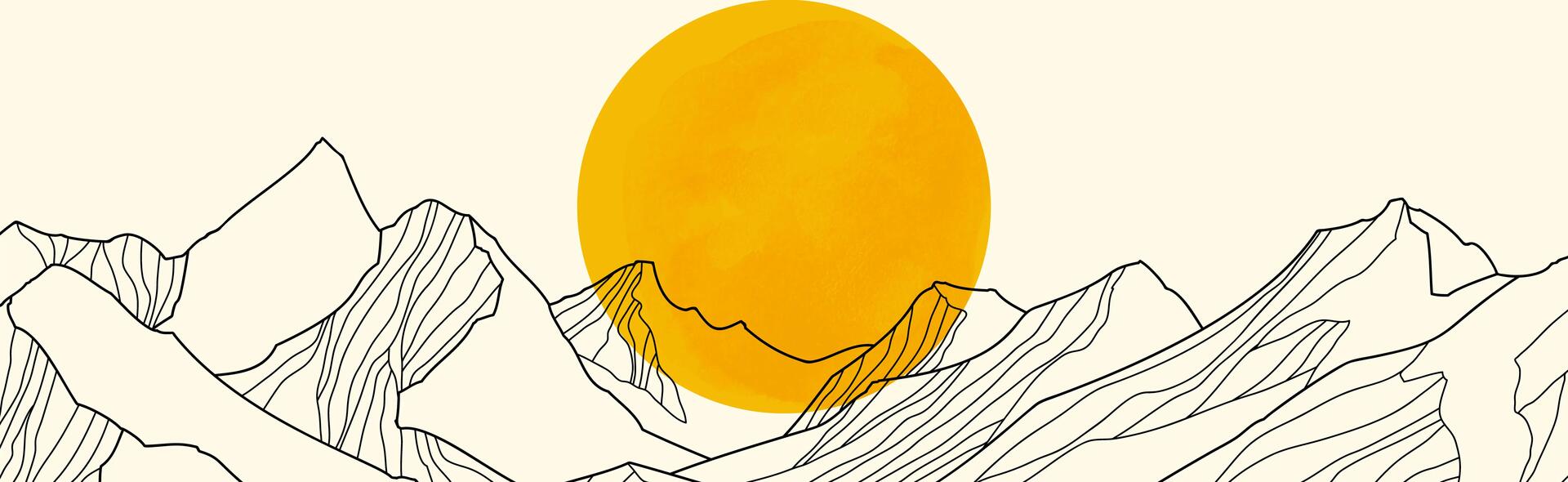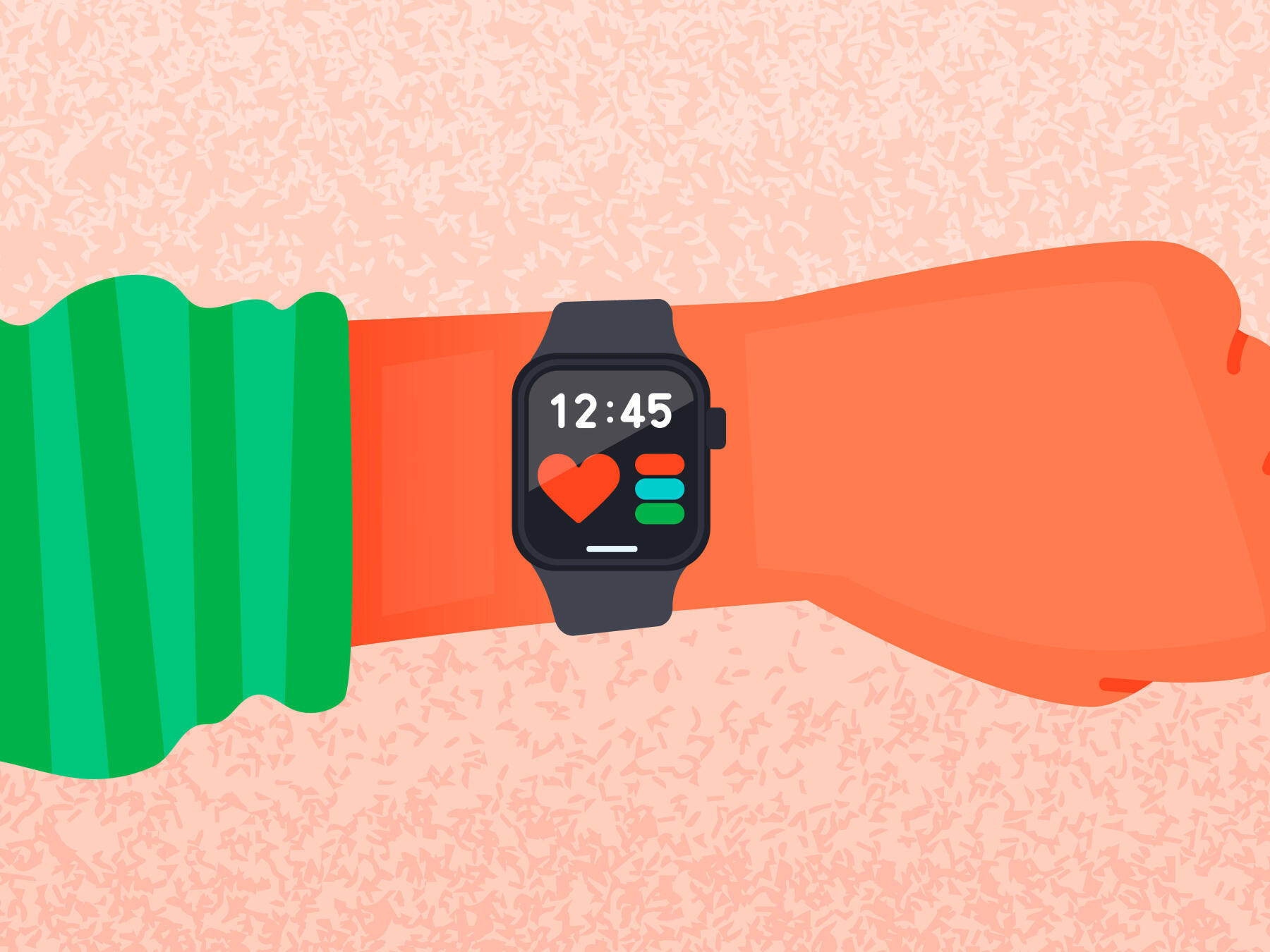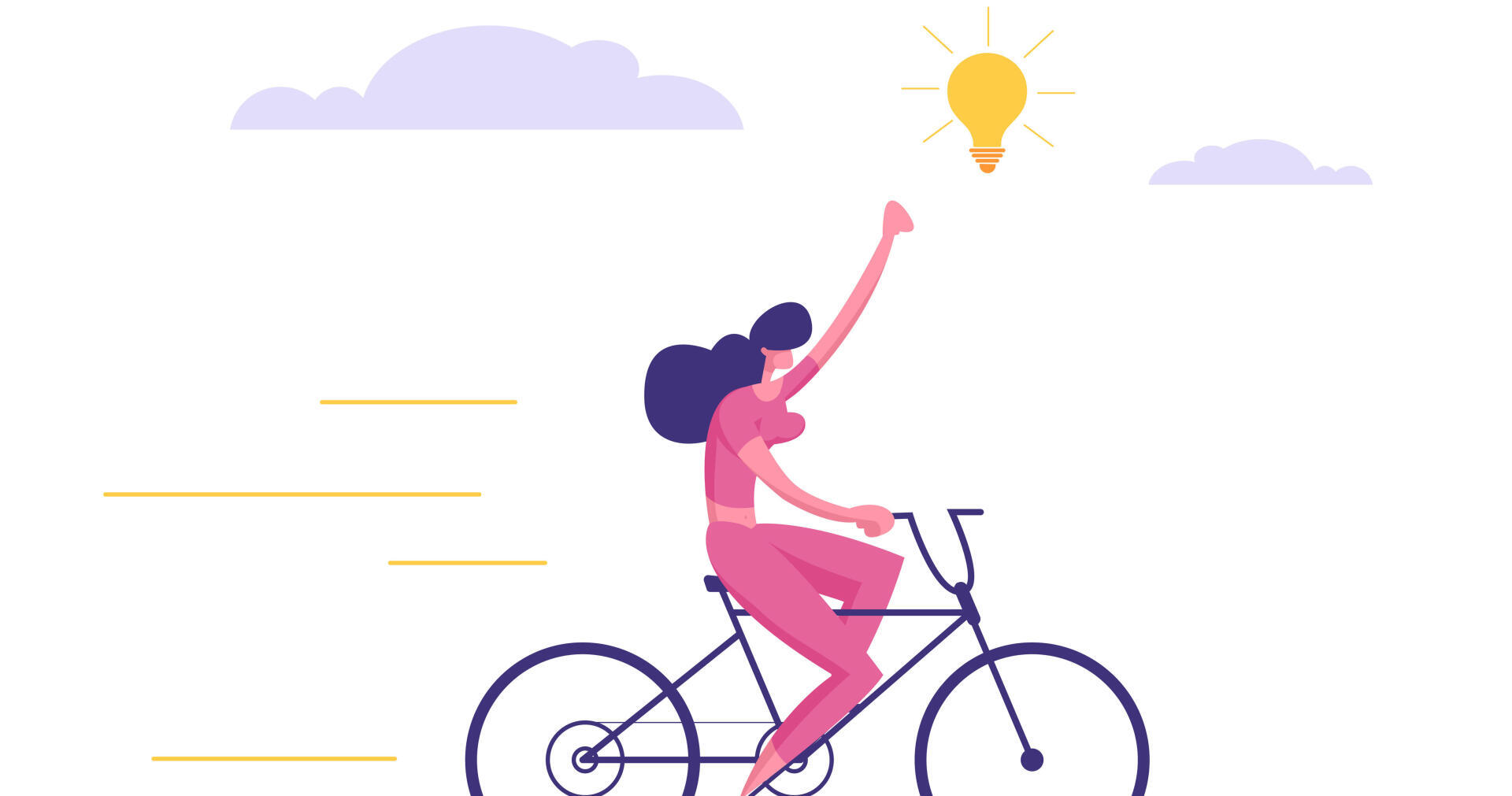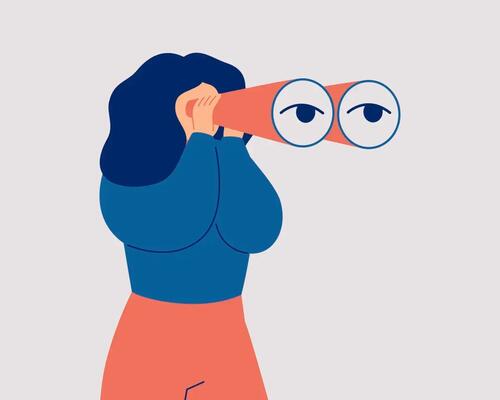Les home-trainers (et zwift)
Les confinements sont encore assez présents dans nos esprits et le home-trainer, avec son appli Zwift (il ne s’agit pas de la seule appli du type, on pourrait également citer Bkool ou Rouvy, mais Zwift est l’application qui s’est le plus imposée) est largement entré dans les maisons des particuliers. Lancée en 2015, la plateforme se situe entre le jeu vidéo et le sport. Oserait-on parler d’esport ? Tout à fait. Le but : pédaler sur son home-trainer. Mais pas n’importe lequel ! Connecté s’il vous plait. L’idée est de simuler du dénivelé, répercuté sur la résistance du home-trainer. En gros, si une côte se profile, vous le sentirez vite dans les cuisses. Après, à vous de pédaler en voyant les paysages défiler sur votre écran. Le truc en plus, par rapport à un vélo d’appartement classique, c’est que vous pouvez intégrer une équipe cycliste, parcourir une étape du Tour de France, etc. Une révolution ? Oui et non. Les home-trainers existent depuis bien longtemps (on trouve des gravures de vélo fixes datées du 18e siècles. On appelait ça des gymnasticon, ça ressemblait plutôt à des vélos d’appartement mais c’est un tout autre sujet qui n’est pas le nôtre maintenant). Bref ! Selon une étude de l’Union Sport & Cycle et de Sport Heroes, 10% des cyclistes réguliers ont acheté un home-trainer lors du premier confinement. Alors oui, les restrictions ont bien aidé à changer les habitudes, il n’empêche : tout était prêt (enfin, sauf les stocks) pour y parvenir. Ce qu’on observe encore aujourd’hui, en ce début 2022, c’est la tendance qui semble s’installer. Les communautés se fédèrent, Zwift lève des fonds et proposent de nouvelles fonctionnalités, les cyclistes peuvent continuer à faire des sorties régulières, même l’hiver ou quand les conditions météo ne s’y prêtent vraiment pas… On n’a pas fini de voir des vélos dans des salons, et trouver ça normal.