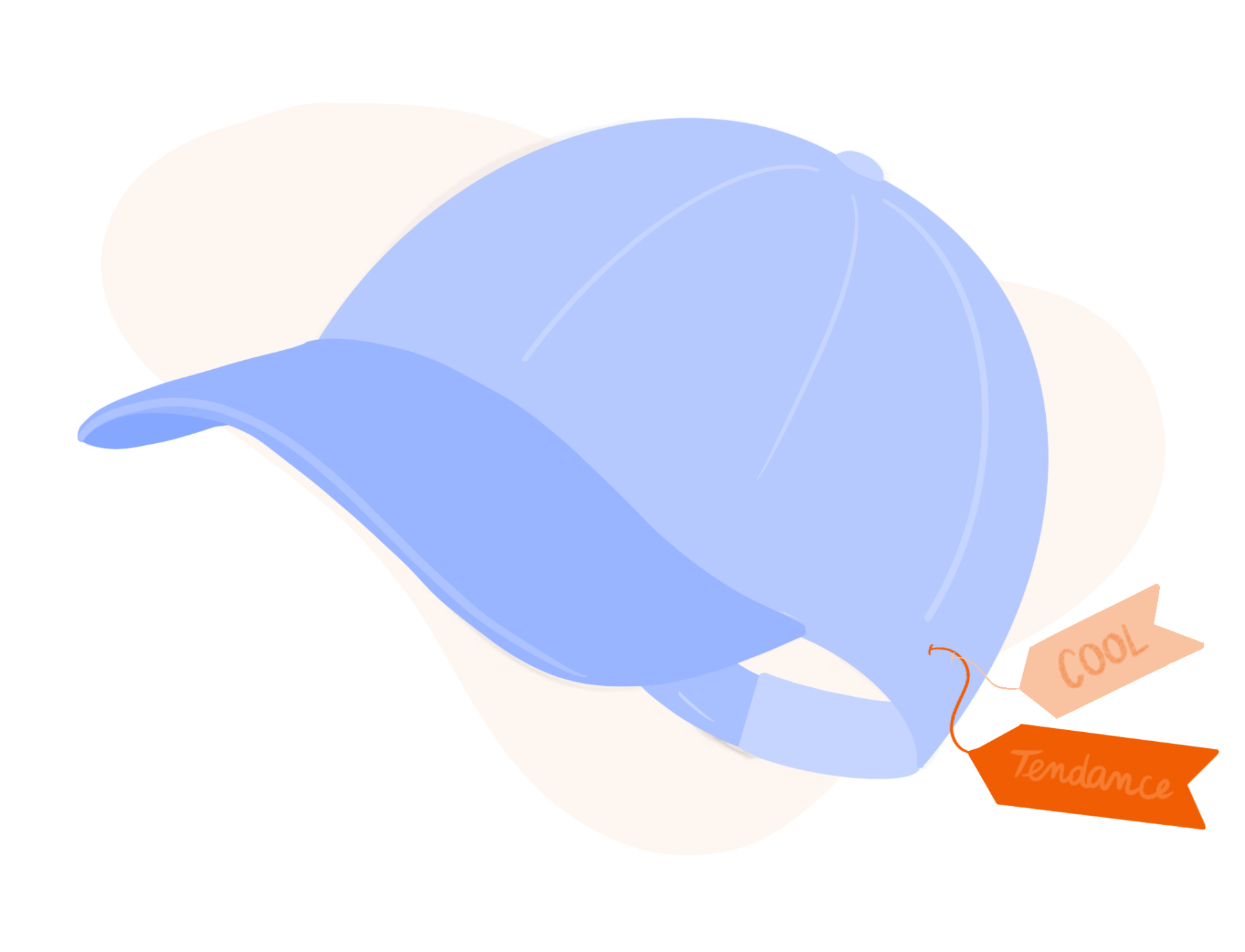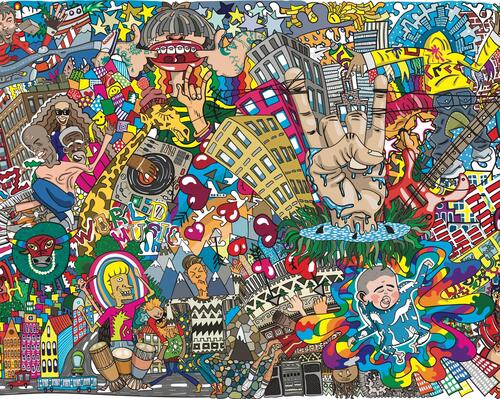Histoire et évolution d’un phénomène de mode
Le vêtement de sport dit “sportswear” est apparu en Europe après la guerre (la seconde).
Ce sont les différents sports de l’époque et les contraintes liées à leur pratique qui ont permis l’apparition des tenues et équipements que l’on connaît aujourd’hui : les tenues légères masculines, la jupe culotte puis le pantalon féminin (une révolution) pour les amatrices de bicyclette, le cardigan pour le golf, les premiers maillots de bain pour la natation, l’équitation a amené le pantalon jodhpurs, le tennis le polo et la jupe plissée pour plus de confort et d’aisance, le ski l’anorak…
Chaque sport voit se dessiner une panoplie, avec pour objectifs à l’époque aisance et performance.